Laïcité et fait religieux dans le champ du sport – « Mieux Vivre ensemble » Un guide du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
En février 2025, alors que la question de la laïcité dans le sport est au cœur du débat public, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative a publié un guide « Mieux Vivre ensemble » afin :
- D’aider les professionnels du sport (agents publics, dirigeants sportifs, éducateurs, etc.) à appréhender les questions de laïcité et de faits religieux dans le domaine sportif
- De les familiariser avec le cadre juridique en vigueur pour garantir le principe de laïcité et de « vivre ensemble »
- De les accompagner à mieux se positionner pour réagir de manière appropriée et apaisée face aux remises en cause de la laïcité
Pour ce faire, 6 fiches explicatives ont été réalisées pour mieux appréhender comment la laïcité se décline dans le champ du sport. Elles sont complétées de mises en situation afin d’illustrer ces notions. Adossées à des références bibliographiques, des exemples d’application dans le champ du sport et des repères juridiques, elles donnent les clés de lecture aux professionnels du milieu sportif.
1/ La liberté religieux et la liberté de manifester sa religion
La liberté religieuse et la liberté de culte, garanties par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et la loi de 1905 et protégées par la Convention européenne des droits de l’homme, incluent le droit d’exprimer, pratiquer ou abandonner une religion. La liberté de manifester ses convictions peut être restreinte pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou de respect de l’ordre public, notamment dans les règlements intérieurs ou chartes éthiques.
En sport, ces restrictions doivent être légitimes, objectives et proportionnées. Il est interdit de restreindre l’expression des convictions religieuses dans les structures sportives sans raison valable, au risque que ces restrictions soient qualifiées de discrimination, passible de sanctions pénales.
2/ La laïcité
La laïcité, fondée sur la loi de 1905, garantit la séparation entre l’État et les religions, assurant ainsi la liberté de conscience pour tous, croyants ou non-croyants. Elle protège la liberté d’expression des convictions religieuses tout en interdisant toute discrimination liée à la religion.
Dans le domaine sportif, la laïcité se déploie différemment selon les espaces : administratif, social, partagé et privé. Dans les structures publiques, la neutralité religieuse s’applique, mais les usagers bénéficient de la liberté de manifester leurs convictions.
Ainsi, dans le sport la laïcité nécessite de concilier la liberté religieuse des pratiquants avec la neutralité imposées aux institutions et délégataires d’une mission de service public, en garantissant le respect de l’ordre public et des règles spécifiques à chaque espace.
3/ Le principe de neutralité
La laïcité repose sur la neutralité de l’État, qui ne favorise aucune religion ni idéologie et garantit la liberté de culte. L’État et les collectivités publiques doivent assurer l’égalité de traitement, sans discrimination ni privilège pour aucune religion, et appliquer cette neutralité à leurs agents publics. Dans le domaine sportif, cette neutralité s’applique aux fédérations sportives délégataires d’une mission de service public, et à leurs acteurs, comme les arbitres, considérés comme des agents publics. Il n’y a pas de distinction en matière de neutralité entre les disciplines sportives, sauf si des contraintes spécifiques de sécurité, hygiène ou ordre public l’exigent, nécessitent des tenues adaptées.
4/ L’application du principe de neutralité par les fédérations sportives et les ligues professionnelles
Les fédérations sportives, qu’elles soient agréées ou délégataires, exercent des missions de service public. Les fédérations délégataires peuvent créer des ligues professionnelles et doivent veiller à respecter les règles de la fédération tout en garantissant l’intérêt général de la discipline. Les fédérations sportives ayant reçu un agrément ou une délégation de service public doivent respecter le principe de neutralité. Cela s’applique à leurs dirigeants, personnels salariés, et aux sportifs sélectionnés en équipe de France, qui doivent également respecter cette neutralité pendant les compétitions. En revanche, les fédérations non agréées ou sans délégation de service public ne sont pas soumises à ce principe, bien que des restrictions de neutralité puissent être imposées si justifiées de manière objective et proportionnée.
5/ Les clubs sportifs et le respect du principe de neutralité
Les clubs sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, ne sont pas soumis au principe de neutralité, n’exerçant pas de mission de service public. Toutefois, les manifestations et compétitions organisées par des fédérations sportives délégataires doivent respecter ce principe, et cela inclut tous les organisateurs, y compris ceux des clubs professionnels le temps de l’événement. Dans les compétitions privées organisées par des clubs sans mission de service public, la liberté religieuse s’applique, mais elle peut être limitée par des restrictions inscrites dans le règlement intérieur. Les pratiquants et licenciés bénéficient de la liberté religieuse. Des restrictions peuvent être imposées si elles sont justifiées et proportionnées (conditions d’hygiène, de sécurité, de prosélytisme). Le personnel des clubs peut également exprimer ses convictions religieuses dans le respect de l’ordre public, mais des politiques de neutralité peuvent être appliquées à certains postes.
6/ L’application du principe de neutralité aux établissements publics sous tutelle du ministère des Sports
Les 22 établissements sous la tutelle du ministère chargé des Sports (17 CREPS et 5 opérateurs nationaux ENSM, ENVSN, IFCE, INSEP, MNS), jouent un rôle dans la mission de service public. Le principe de neutralité s’applique à leurs agents, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels ou prestataires exécutants. En revanche, ce principe ne s’étend pas aux usagers de ces établissements, tels que les stagiaires ou les sportifs, qui ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité en tant qu’usagers du service public. Toutefois, des aménagements de ce principe peuvent être nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité lors de la pratique sportive.
Enfin, 10 mises en situation permettent d’illustrer les cadres juridiques et les solutions que peuvent mettre en place les professionnels :
- Interdiction du port du voile par un gérant de salle de remise en forme
- Le port d’un turban sikh par un arbitre pendant une rencontre sportive
- Le refus d’une fédération nationale d’autoriser un couvre-chef à caractère religieux aux participants d’une compétition internationale
- Le port d’une tenue de bain couvrant par une nageuse dans une piscine municipale
- Le jeûne d’un sportif dans un CREPS
- Le souhait de se restaurer en conformité avec les prescriptions religieuses au sein d’un CREPS
- La prière observée par certains sportifs dans un vestiaire avant une rencontre sportive
- Le signe de croix (ou tout signe d’adhésion à un culte) d’un sportif professionnel en rentrant sur le terrain sportif
- Le refus de serrer la main d’une arbitre par une partie de l’équipe sportive pour un motif religieux
- L’ouverture de créneaux spécifiques pour les femmes dans une piscine publique
Téléchargez le guide « Mieux Vivre Ensemble » sur le site du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative ou en cliquant ici
Les derniers articles :
- Baromètre ANDES – Budget 2026 : réalités et impacts
- [Partage d’expérience] Le gymnase de Montluçon à l’honneur dans Esprit Bad de la FFBad
- Rencontres voile, collectivités et territoires avec la FFVoile
- Replay matinale ANDES – Vœux 2026
- Replay matinale ANDES – Présentation de l’observatoire de l’économie du Sport de la BPCE
Les plus lus
Covid-19 : Nouvelles mesures applicables au secteur du sport – Maj 14/03/2022
Odeyssa DENIS, ANDES, Publié le 26 novembre 2021
Covid-19 : Nouvelles mesures applicables au secteur du sport – 08/04/2021 (mise à jour au 20/04/2021)
Odeyssa DENIS, ANDES, Publié le 6 avril 2021
Publication du décret sur les BNSSA : l’ANDES fait part de son soulagement et de la responsabilité des acteurs sur l’avenir de la filière aquatique
Odeyssa DENIS, ANDES, Publié le 4 juin 2023
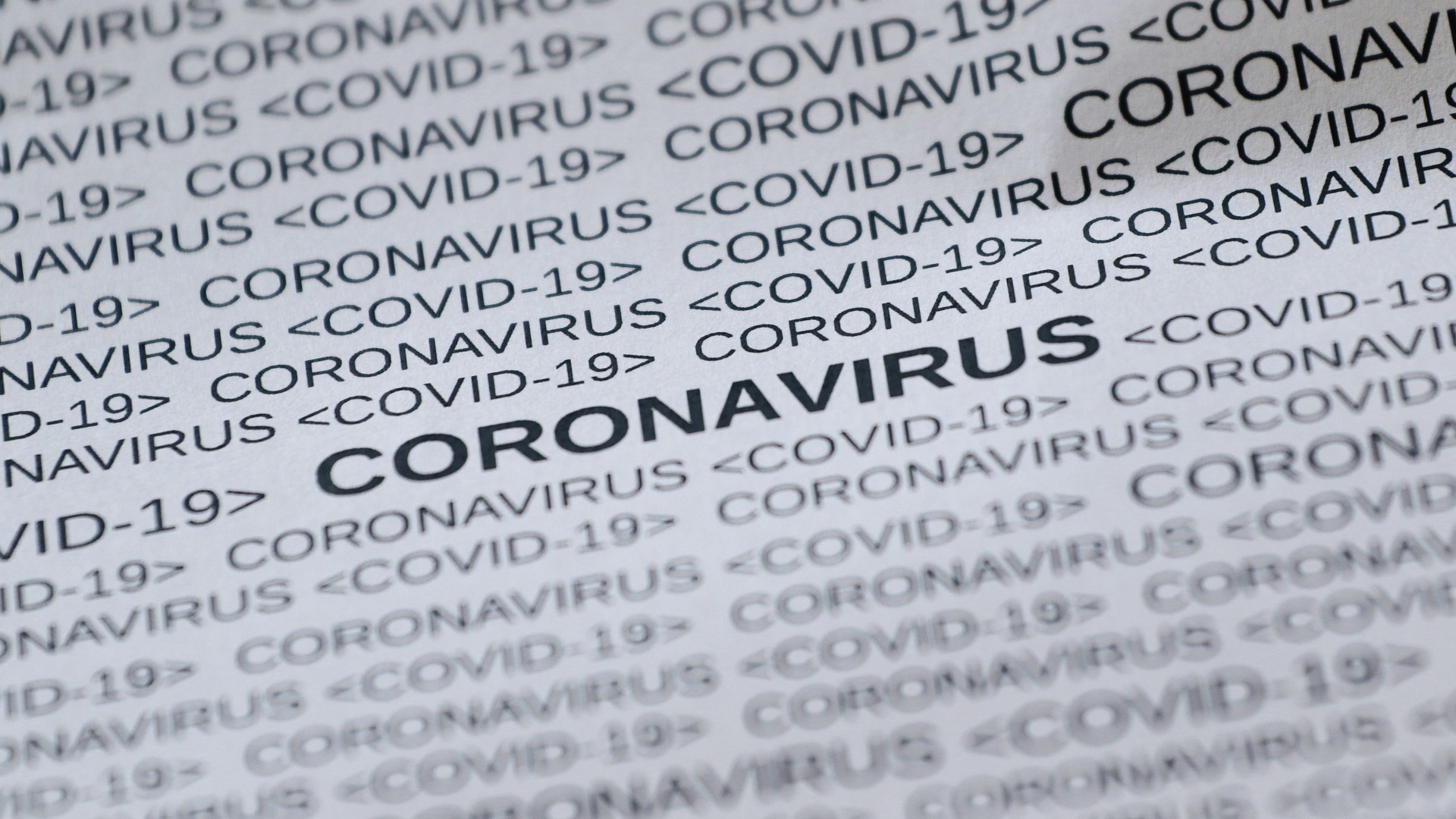

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.